Cette rubrique recense l’essentiel de mes publications, des plus récentes aux plus anciennes, classées par catégorie: livres, numéros spéciaux de revues, articles, contributions à des ouvrages collectifs, autres.
OUVRAGES
La guerre Russie-Ukraine. Une analyse réaliste
Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal
2024, 288 p.
 Cet ouvrage présente les raisons à l’origine de la guerre Russie-Ukraine et de son escalade de 2022 par rapport à 2014, retrace son déroulement au cours de ses 20 premiers mois compte tenu aussi du jeu des puissances tierces, et s’interroge sur sa signification en termes d’impact à moyen terme sur le système international. L’analyse proposée est d’inspiration réaliste: si cette guerre a à ce point choqué l’opinion publique dans les pays occidentaux, c’est qu’elle met à mal les thèses libérales de la fin de l’histoire, de l’obsolescence des guerres majeures, de la gouvernance sans gouvernement en gestation dans un monde globalisé. La perspective réaliste permet d’affirmer qu’avec ce qu’il appelle son ‘opération militaire spéciale’, ce n’est pas la sécurité de la Russie que Vladimir Poutine cherche à garantir mais sa puissance et sa gloire qu’il cherche à retrouver. De même, les attitudes des pays tiers renvoient à leur intérêt national plutôt qu’à leurs affinités politiques, alors que la guerre se terminera par la victoire de l’Ukraine pour la raison simple que refusant de perdre sous peine de disparaître, elle finira par l’emporter. Enfin, cette guerre corrobore le postulat de l’autonomie du politique par rapport et au droit et à l’économie, de même qu’elle consolide et l’OTAN et l’hégémonie américaine en réhabilitant la puissance dure comme condition sine qua non de la stabilité mondiale.
Cet ouvrage présente les raisons à l’origine de la guerre Russie-Ukraine et de son escalade de 2022 par rapport à 2014, retrace son déroulement au cours de ses 20 premiers mois compte tenu aussi du jeu des puissances tierces, et s’interroge sur sa signification en termes d’impact à moyen terme sur le système international. L’analyse proposée est d’inspiration réaliste: si cette guerre a à ce point choqué l’opinion publique dans les pays occidentaux, c’est qu’elle met à mal les thèses libérales de la fin de l’histoire, de l’obsolescence des guerres majeures, de la gouvernance sans gouvernement en gestation dans un monde globalisé. La perspective réaliste permet d’affirmer qu’avec ce qu’il appelle son ‘opération militaire spéciale’, ce n’est pas la sécurité de la Russie que Vladimir Poutine cherche à garantir mais sa puissance et sa gloire qu’il cherche à retrouver. De même, les attitudes des pays tiers renvoient à leur intérêt national plutôt qu’à leurs affinités politiques, alors que la guerre se terminera par la victoire de l’Ukraine pour la raison simple que refusant de perdre sous peine de disparaître, elle finira par l’emporter. Enfin, cette guerre corrobore le postulat de l’autonomie du politique par rapport et au droit et à l’économie, de même qu’elle consolide et l’OTAN et l’hégémonie américaine en réhabilitant la puissance dure comme condition sine qua non de la stabilité mondiale.
Introduction : L’opération militaire spéciale, une guerre de choix !
Partie I – Comprendre les raisons : Pour-quoi la guerre ?
- Les objectifs de la guerre : Poutine avec ‘P’ majuscule comme Puissance
- Le moment de la guerre : Revenir par la fenêtre … de tir
- L’utilité de la guerre : Deux tu l’auras valent mieux qu’un tiens
Partie II – Retracer le déroulement : Comment la guerre ?
- La guerre conventionnelle après la guerre hybride : La meilleure attaque est la défense
- Les États-tiers spectateurs engagés : Chacun pour soi
- L’issue de la guerre : Et le gagnant est …
Partie III – Induire les conséquences : Quels effets la guerre ?
- L’autonomie du politique : Les passions plus fortes que les intérêts et les institutions
- Puissances civile, normative, douce : Pour qui sonne le glas
- Le siècle américain 1941-2041/2049 : Durer provient de dur
Digression : Demain la guerre, obstinée ou obsolète ?
Théories des relations internationales
Paris, Sciences Po les Presses, 2019
6ème édition mise à jour, 802 p.

Destiné aux étudiants et enseignants en relations internationales, ce manuel pédagogique et exhaustif, dont la première édition remonte à 2003, en est à sa 6é édition, et celle-ci a bénéficié des apports de deux de mes docteurs – Jérémie Cornut et Élie Baranets. Il présente les principaux paradigmes, concepts et débats structurants de la discipline des RI, après avoir située celle-ci dans son environnement épistémologique et historique, et avant de s’interroger sur ses évolutions les plus récentes. Chaque chapitre est accompagné de bibliographies commentées qui, jointes à la bibliographie générale, permettent au lecteur de se référer aux textes fondamentaux et sources de seconde main. La troisième édition a été traduite en chinois, et la quatrième en portugais (Brésil).
I. Les RI comme science sociale
1. Théorie et RI
2. Les RI dans l’histoire des idées politiques
3. L’évolution de la discipline des RI
II. Théories générales
4. Le paradigme réaliste
5. La vision libérale
6. La perspective transnationaliste
7. L’héritage marxiste
8. Les approches post-positivistes
9. Le projet constructiviste
10. Les études féministes
III. Débats sectoriels
11. La politique étrangère
12. La diplomatie
13. L’intégration
14. La coopération
15. L’économie politique internationale
16. La sécurité
17. La guerre et la paix
IV. Les RI face au monde contemporain
18. Théorie et pratique des RI
19. Présent et futur des RI
20. Les Relations internationales en France
Lire la critique de la 1ère édition par Jean Klein dans Politique étrangère.
Lire la critique de la 1ère édition par Josepha Laroche dans la Revue internationale et stratégique.
Lire la critique de la 1ère édition par Dany Deschênes dans le Canadian Journal of Political Science.
Lire la critique de la 2ème édition par Yves Laberge dans Etudes internationales.
Lire la critique de la 2ème édition par Pierre-Emmanuel Guittet et Amandine Scherrer dans Cultures et conflits.
Un monde unidimensionnel
Paris, Sciences Po les Presses, 2015
2ème édition augmentée d’une postface inédite, 188 p.
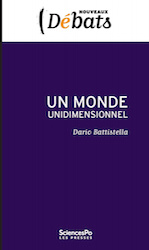 Cet essai propose un modèle conceptuel pour rendre compte de la politique internationale du début du XXIe siècle, suite au constat que vingt ans après la chute du mur de Berlin, les scénarios de Fukuyama, Krauthammer, Huntington et Kissinger ne se sont pas réalisés. A l’encontre des discours soulignant la multiplication des menaces pesant sur la sécurité des démocraties occidentales, il montre que l’ordre mondial est à la fois stratégiquement pacifique parce que composé d’un système interétatique unipolaire sur le plan de la puissance, et idéologiquement pacifié parce que constitué d’une société internationale unitive sur le plan de la légitimité. Succédant aux puissances espagnole, autrichienne, française, et anglaise du XVIe au XIXe siècles, chacune imposant tour à tour son système de valeurs, le monde contemporain est synonyme de prééminence matérielle des États-Unis et d’hégémonie normative d’un libéralisme international revisité. La postface de la 2e édition, publiée 4 ans après la première, confirme que cet ordre unidimensionnel n’est remis en cause ni par le revivalisme islamiste, ni par le révisionnisme russe, ni par l’ascension chinoise.
Cet essai propose un modèle conceptuel pour rendre compte de la politique internationale du début du XXIe siècle, suite au constat que vingt ans après la chute du mur de Berlin, les scénarios de Fukuyama, Krauthammer, Huntington et Kissinger ne se sont pas réalisés. A l’encontre des discours soulignant la multiplication des menaces pesant sur la sécurité des démocraties occidentales, il montre que l’ordre mondial est à la fois stratégiquement pacifique parce que composé d’un système interétatique unipolaire sur le plan de la puissance, et idéologiquement pacifié parce que constitué d’une société internationale unitive sur le plan de la légitimité. Succédant aux puissances espagnole, autrichienne, française, et anglaise du XVIe au XIXe siècles, chacune imposant tour à tour son système de valeurs, le monde contemporain est synonyme de prééminence matérielle des États-Unis et d’hégémonie normative d’un libéralisme international revisité. La postface de la 2e édition, publiée 4 ans après la première, confirme que cet ordre unidimensionnel n’est remis en cause ni par le revivalisme islamiste, ni par le révisionnisme russe, ni par l’ascension chinoise.
Lire la critique de Michaël Maira dans Politique et Sociétés.
Lire la critique de Philippe Perchoc dans Critique Internationale.
Lire la critique de Delphine Deschaux-Beaume dans la RFSP.
Relations internationales. Bilan et perspectives
Paris, Ellipses, 2013, 572 p.
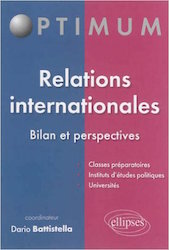 Cet ouvrage collectif dresse un état des lieux des RI comme discipline et comme objet. Réunissant la fine fleur des internationalistes francophones de France, de Belgique, du Québec et d’ailleurs, il est articulé autour de 3 problématiques : Qu’est-ce que les RI? Comment fonctionnent-elles? A quoi servent-elles? Dans chacune des contributions, un spécialiste de la thématique concernée dresse le bilan de la littérature académique et des débats en cours, avant d’inscrire son analyse dans la perspective de ses propres recherches.
Cet ouvrage collectif dresse un état des lieux des RI comme discipline et comme objet. Réunissant la fine fleur des internationalistes francophones de France, de Belgique, du Québec et d’ailleurs, il est articulé autour de 3 problématiques : Qu’est-ce que les RI? Comment fonctionnent-elles? A quoi servent-elles? Dans chacune des contributions, un spécialiste de la thématique concernée dresse le bilan de la littérature académique et des débats en cours, avant d’inscrire son analyse dans la perspective de ses propres recherches.
I. Les Relations internationales, une science sociale
I A. Une discipline universitaire institutionnalisée
1. Avant la science. Les relations internationales dans l’histoire de la pensée (Frédéric Ramel, Sciences Po Paris)
2. Les Relations internationales comme science. Un champ scientifique ? (Alex Mcleod, UQàM)
3. Vers une science normale ? Les Relations internationales entre paradigmatisme et combinaison (Jérémie Cornut, McGill)
I B. Des approches théoriques plurielles
4. Le réalisme. Une tradition de recherche bien vivante (Pascal Vennesson, Nangyang TU, Singapour)
5. Le libéralisme. Projet théorique et doctrine normative (Stéphane Roussel, ÉNAP)
6. Les constructivismes. Pour un constructivisme critique (Thierry Balzacq, Louvain)
I C. Des affinités disciplinaires sélectives
7. Relations internationales et histoire. Comprendre le monde, de l’unique à l’universel (François David, Lyon-III)
8. Relations internationales et droit international. Entre séparation et articulation (Olivier Corten, ULB)
9. Relations internationales et économie internationale. L’économie politique internationale (Stéphane Paquin, ÉNAP)
II. Les Relations internationales, une science jeune
II A. Des concepts fondamentaux disputés
10. Souveraineté. Évolution conceptuelle d’une notion clé (Xavier Mathieu, Sheffield)
11. Sécurité. Un concept polysémique (Barbara Delcourt, ULB)
12. Puissance. Vers une approche synthétique ? (Dario Battistella, IEP Bordeaux)
II B. Des objets classiques revisités
13. Le postulat de Westphalie. Mythe et réalité d’un tournant (Thomas Meszaros, Lyon-III)
14. L’étude des guerres. Le paradigme de la reconnaissance (Thomas Lindemann, Versailles Saint-Quentin)
15. L’analyse de la politique étrangère. À l’épreuve de la nouvelle scène mondiale (Frédéric Charillon, Clermont-Ferrand)
II C. Des thématiques nouvelles abordées
16. Études européennes. Des théorisations au fil de l’eau (Sabine Saurugger, IEP Grenoble)
17. Études régionales. Relations internationales et – nouveau – régionalisme (Jean-Marie Chenou, Lausanne)
18. Politiques publiques internationales. Penser le redéploiement des échelles de la régulation politique (Charlotte Halpern, Sciences Po Paris)
III. Les Relations internationales, une science utile
III A. Les acteurs majeurs analysés
19. États nationaux. Cycles de la territorialité et règne des États-continent ? (Gérard Dussouy, Bordeaux-IV)
20. Organisations internationales. Pour un regard transdisciplinaire et socio-historique (Delphine Placidi-Frot, Paris-XI)
21. Acteurs transnationaux. Amplification contemporaine d’un phénomène ancien (Gilles Bertrand, IEP Bordeaux)
III B. Les enjeux globaux élucidés
22. Rapports Nord-Sud. Inégalités et développement (Philippe Marchesin, Panthéon-Sorbonne)
23. L’environnement saisi par les Relations internationales. L’écopolitique internationale (Jean-Frédéric Morin, ULB et Ina Lehmann, Uni Bremen)
24. Mondialisation et gouvernance. L’hypothèse de la gouvernemance (Pierre Vercauteren, UCL Mons)
III C. L’ordre mondial prospecté
25. Quel après-guerre froide ? Un monde unidimensionnel (Dario Battistella, IEP Bordeaux)
26. Des puissances émergentes ? Portée et limites d’un phénomène international (Sebastian Santander, Liège)
27. L’Union Européenne acteur ? Une organisation régionale à vocation globale (Franck Petiteville, IEP Grenoble)
Dictionnaire des relations internationales
Paris, Dalloz, 2012, 3ème édition, 572 p.
Co-écrit avec Marie-Claude Smouts (CERI-Sciences Po Paris) et Pascal Vennesson (IUE Florence) pour ce qui est des deux premières éditions de 2003 et 2006, auxquels s’est ajouté Franck Petiteville (IEP Grenoble) pour la 3e édition, ce dictionnaire se propose de donner les définitions, l’origine, l’évolution, et l’utilité des principaux concepts, approches, et doctrines des relations internationales.
Parmi les quelque 150 entrées: anarchie, biens publics mondiaux, choc des civilisations, constructivisme, diplomatie, effet de serre, frontière, géopolitique, guerre, ingérence humanitaire, Monroe (doctrine), négociation internationale, organisations non-gouvernementales, OTAN, prolifération, réalisme, religion et RI, souveraineté, state-building, territoire, Union européenne, westphalien (système), etc.
Des références bibliographiques accompagnent chaque entrée, signalant les œuvres fondatrices et les travaux plus récents. Un système de renvoi et un index permettent une consultation aisée et dynamique.
Paix et guerres au 21e siècle
Auxerre, Editions Sciences Humaines, 2011, 160 p.
 Ce livre se propose de rendre compte de la dialectique de la paix et de la guerre dans le monde de l’après-guerre froide. Le système international est caractérisé par une stabilité d’ensemble : la paix prévaut entre grandes puissances en général, et entre démocraties occidentales en particulier. La paix systémique s’explique par la structure unipolaire du système interétatique dominé par les États-Unis. Au sein de cette hiérarchie, les États occidentaux forment une communauté démocratique qui explique la paix régionale dont ils jouissent dans leurs relations réciproques. La face cachée de cette paix systémique réside dans les guerres d’intervention menées par les démocraties contre des régimes qualifiés de voyous. A part, des guerres locales limitées, sans incidence sur la stabilité systémique, se poursuivent entre entités dont les relations sont constitutives d’inimitiés durables parce qu’elles se nient mutuellement le droit d’exister – Pakistanais et Indiens d’un côté, Israéliens et Palestiniens de l’autre.
Ce livre se propose de rendre compte de la dialectique de la paix et de la guerre dans le monde de l’après-guerre froide. Le système international est caractérisé par une stabilité d’ensemble : la paix prévaut entre grandes puissances en général, et entre démocraties occidentales en particulier. La paix systémique s’explique par la structure unipolaire du système interétatique dominé par les États-Unis. Au sein de cette hiérarchie, les États occidentaux forment une communauté démocratique qui explique la paix régionale dont ils jouissent dans leurs relations réciproques. La face cachée de cette paix systémique réside dans les guerres d’intervention menées par les démocraties contre des régimes qualifiés de voyous. A part, des guerres locales limitées, sans incidence sur la stabilité systémique, se poursuivent entre entités dont les relations sont constitutives d’inimitiés durables parce qu’elles se nient mutuellement le droit d’exister – Pakistanais et Indiens d’un côté, Israéliens et Palestiniens de l’autre.
Lire la critique de Christian Thuderoz dans Négociations.
Retour de l’état de guerre
Paris, Armand Colin, 2006, 296 p.
The Return of the State of War.
A Theoretical Analysis of Operation ‘Iraqi Freedom’
Colchester, ECPR Press, 2008, 204 p.
Le 18 mars 2003, les États-Unis de George Bush fils attaquent l’Irak de Saddam Hussein au cours de l’opération « Liberté en Irak ». Rappelant à priori l’offensive menée en 1991 par George Bush père, l’intervention de 2003 est en fait radicalement différente.
 Parce qu’elle est entreprise au nom de l’autorité souveraine des États-Unis à utiliser la force pour assurer leur propre sécurité nationale, en dehors de toute autorisation de l’ONU et à l’encontre de la volonté de plusieurs alliés, elle réhabilite l’idée de la guerre comme simple continuation de la politique extérieure. Ce faisant, les États-Unis entrouvrent la porte au retour de l’état de guerre tel que défini par Hobbes.
Parce qu’elle est entreprise au nom de l’autorité souveraine des États-Unis à utiliser la force pour assurer leur propre sécurité nationale, en dehors de toute autorisation de l’ONU et à l’encontre de la volonté de plusieurs alliés, elle réhabilite l’idée de la guerre comme simple continuation de la politique extérieure. Ce faisant, les États-Unis entrouvrent la porte au retour de l’état de guerre tel que défini par Hobbes.
Cet essai s’efforce de comprendre les raisons de l’opération « Liberté en Irak », sa portée et sa signification pour l’ordre international au XXIe siècle.
En s’appuyant sur la théorie et l’histoire des relations internationales, il démontre qu’au fil du temps une société internationale a vu le jour, synonyme d’ordre pacifié plus ou moins stable dont les États-Unis ont d’ailleurs été le principal promoteur.
Or, l’opération « Liberté en Irak » rompt brusquement avec cette évolution, en réintroduisant des pratiques caractéristiques du droit du plus fort, du fait de la  stigmatisation de l’Irak comme ennemi, de la réhabilitation de la guerre préventive, du triomphe de l’unilatéralisme au détriment du multilatéralisme.
stigmatisation de l’Irak comme ennemi, de la réhabilitation de la guerre préventive, du triomphe de l’unilatéralisme au détriment du multilatéralisme.
Pourquoi ce retournement ? Le nouveau comportement américain renvoie-t-il au dilemme de sécurité que les États-Unis ressentiraient suite à 9/11 ? Est-il dû à de simples causes conjoncturelles d’ordre intérieur, à des intérêts particuliers tant matériels qu’idéologiques? Ou bien sa cause fondamentale est-elle à chercher dans l’évolution à plus long terme du système international et de la distribution de la puissance, synonyme de déclin relatif anticipé des États-Unis ?
Enfin, à quelles suites éventuelles s’attendre en ce début du XXIe siècle: Liberté en Irak est-elle un tournant ou simplement une parenthèse ?
C’est à l’ensemble de ces questions que s’efforce de répondre cet essai, traduit en anglais deux ans après sa parution en France.
Lire la critique de Dany Deschênes dans Etudes internationales.
Lire la critique de Thomas Lindemann dans Défense nationale.
Lire la critique de Milos Jovanovic dans Politique étrangère.
Lire la critique de Jean-Loup Samaan dans la RFSP.
Read the review by Henrik Syse in the Journal of Peace Research.
NUMÉROS DE REVUE
« La théorie internationale face au 11 septembre et à ses conséquences. Perspectives libérales et critiques »
Etudes internationales, 36 (4), décembre 2004
D. Battistella
Introduction. Le réalisme réfuté?
Y. Ferguson et J. Rosenau
De la superpuissance avant et après le 11 septembre. Une perspective post-internationale
J. Oneal et B. Russett
A la recherche de la paix dans un monde d’après-guerre froide caractérisé par l’hégémonie et le terrorisme
D. Battistella
Prendre Clausewitz au mot. Une explication libérale de ‘Liberté en Irak’
F. Beer et R. Hariman
Le post-réalisme après le 11 septembre
« Peut-on penser un ordre international? »
Revue internationale et stratégique, N° 54, été 2004
D. Battistella
Introduction. L’ordre international, norme politiquement construite
D. Battistella
L’ordre international. Portée théorique et conséquences pratiques d’une notion réaliste
G. Bertrand
Ordre international, ordre mondial, ordre global
L. Rucker
La contestation de l’ordre international. Les Etats révolutionnaires
E. Puig
L’ordre et la menace. Analyse critique du discours de la menace chinoise en RI
V. Pouliot et N. Lachmann
Les communautés de sécurité, vecteurs d’ordre régional et international
« Le retour de la guerre »
Raisons politiques, N° 13 nouvelle série, février 2004
D. Battistella
Introduction. Le retour de la guerre
S. Launay
Quelques formes et raisons de la guerre
T. Lindemann
Les guerres américaines dans l’après-guerre froide. Entre intérêt national et affirmation identitaire
D. Battistella
‘Liberté en Irak’ ou le retour de l’anarchie hobbienne
M. Fortmann et J. Goumand
L’obsolescence des guerres interétatiques? Une relecture de John Mueller
A. Mercier
Guerres et médias. Permanences et mutations
ARTICLES
« Des RI françaises en émergence? Les internationalistes français dans le sondage TRIP 2011 » (co-écrit avec Jérémie Cornut)
Revue française de science politique, 63 (2), mars-avril 2013, p. 303-336
Où en sont les RI françaises, à la fois au sein de l’université française, et au sein de la discipline globale des RI? Pour apporter des éléments de réponses à cette question, cet article, dont l’initiative et l’essentiel du travail reviennent à Jérémie Cornut, utilise les résultats obtenus par le quatrième sondage TRIP (Teaching, Research, and International Policy), projet de recherche lancé par D. Maliniak, M. Tierney et S. Peterson au William & Mary College à Williamsburg en Virgine. En septembre 2011, 3 466 internationalistes de 20 pays différents ont fait l’objet de cette enquête qui, pour la première fois, a pris en compte des RI dans des pays non-anglo-saxons. Les réponses des 101 Français qui ont accepté de répondre au sondage – sur un peu moins de 300 contactés – indiquent certaines tendances au sujet de la place des RI dans l’université française, de l’éventuelle existence de RI à la française et de leur lien avec la multidisciplinarité, du positionnement des internationalistes français par rapport aux tendances en cours dans les RI mondiales, de leur attitude par rapport aux praticiens des relations internationales, et de la question de la langue française dans une discipline d’origine et d’expression anglo-américaines. Le bilan qui ressort de cette étude est ambigu : se dessinent les prémices d’une émergence des RI françaises, même si un certain nombre d’éléments invitent à relativiser ce constat.
« Raymond Aron, réaliste néoclassique »
Etudes internationales, 47 (3), septembre 2012, p. 371-388
Cet article défend la thèse que le réalisme de Raymond Aron était un réalisme néoclassique avant la lettre, en approfondissant une intuition restée sans suite de Michael Doyle dans Ways of War and Peace. L’article fait partie d’un numéro spécial sur R. Aron et les RI. 50 ans après Paix et guerre entre les nations coordonné par Jean-Vincent Holeindre et incluant notamment un inédit de R. Aron intitulé Clausewitz et notre temps.
« L’Occident, exportateur de démocratie »
Politique étrangère, 76 (4), décembre 2011, p. 813-824
Cet article étudie les interventions militaires occidentales qui se sont multipliées depuis une vingtaine d’années tant au sein des Etats faillis que contre des Etats voyous, et qui visent à protéger les populations locales, défendre les libertés fondamentales ou rétablir la démocratie. Il montre que si ces interventions armées sont facilitées et légitimées par une relecture néolibérale du droit international, leurs racines idéologiques n’en remontent pas moins à la période des conquistadores et à la perception d’autrui comme barbare. Les Etats faillis et voyous sont aux démocraties libérales ce que les païens étaient aux chrétiens et les sauvages aux civilisés, avec pour conséquence l’échec programmé des politiques de state-building et autres foreign imposed regime changes.
« La notion d’empire en théorie des relations internationales »
Questions Internationales, N° 26, juillet-août 2007, p. 27-32
Traditionnellement sous-étudiée, sinon ignorée, dans une discipline volontiers stato-centrée et présentiste, la notion d’empire est redécouverte depuis que l’après-guerre froide est caractérisée par une structure unipolaire et par des tentations impériales de la part des Etats-Unis de George W. Bush.
« Prendre Clausewitz au mot. Une explication libérale de ‘Liberté en Irak' »
Etudes internationales, 34 (4), décembre 2004, p. 667-687
Dans son ‘De la guerre’, Clausewitz voit dans la guerre la simple continuation de la politique par d’autres moyens. Réaliste, il pose que c’est de la politique extérieure dont la guerre est la continuation; que c’est l’intérêt national donc qu’une guerre cherche à satisfaire. Mais il envisage que la politique extérieure puisse parfois servir des intérêts autres que l’intérêt national. Cet article corrobore cette hypothèse, centrale dans les théories libérales/Innenpolitik de la politique internationale en général (Moravcsik) et de l’impérialisme en particulier (Hobson, Schumpeter, Snyder), en montrant que la décision américaine de lancer Liberté en Irak peut être attribuée à certains intérêts mesquins tant matériels que idéologiques d’une minorité d’acteurs sociétaux américains bien représentées dans/par l’administration Bush.
« L’ordre international. Portée théorique et conséquences pratiques d’une notion réaliste »
Revue internationale et stratégique, N° 54, été 2004, p. 89-98
Cet article tente de montrer que l’ordre international, défini dans un perspective réaliste comme synonyme de stabilité, au sens d’absence de guerres majeures entre grandes puissances, est bien davantage susceptible d’être assuré dans un système unipolaire plutôt que dans un système d’équilibre, que ce dernier soit multi- ou bipolaire. Tant la cohérence d’ensemble de l’approche réaliste que les exemples historiques des périodes successives du système westphalien vont dans ce sens.
« ‘Liberté en Irak’ ou le retour de l’anarchie hobbienne »
Raisons politiques, N°13 nouvelle série, février 2004, p. 59-78
Alors que le drame de la deuxième guerre du Golfe n’avait pas remis en cause la tendance en cours vers la consolidation de la logique lockienne comme culture internationale dominante, l’opération « Liberté en Irak » se présente comme une tragédie, dans la mesure où elle annonce l’abandon, de la part des États-Unis, de la culture lockienne au profit d’une logique hobbienne. La construction de l’Irak comme ennemi, l’usage de la guerre préventive et le recours à l’unilatéralisme sont autant d’indices du retour possible de l’état de guerre comme structure dominante de la scène politique internationale de demain.
« L’apport de Karl Deutsch à la théorie des RI »
Revue internationale de politique comparée, 10 (4), décembre 2003, p. 567-585
Cet article montre que l’apport de K. Deutsch à la théorie des RI réside moins dans sa méthode behaviouraliste que dans sa substance anti-réaliste. Le concept de communauté de sécurité, synonyme de paix résultant de l’attente pacifique réciproque entre sociétés multipliant les flux de communications de toutes sortes entre elles, prépare en effet le terrain aux concepts de société mondiale de John Burton, de paix démocratique de Bruce Russett, et d’anarchie kantienne de Alexander Wendt.
« Une utopie passéiste. Le monde selon Henry Kissinger »
Le Débat, N°95, mai-août 1997, p. 152-162
Cet article est une réaction critique à l’ouvrage ‘Diplomatie’ de Henry Kissinger, à la fois relecture réaliste de l’histoire de la politique internationale et prévision pour l’après-guerre froide.
« De la démocratie en politique extérieure. Après-guerre froide et domaine réservé »
Le Débat, N°88, janvier-février 1996, p. 116-134
Cet article défend l’hypothèse que la fin de la guerre froide n’a en rien changé la façon dont les démocraties libérales conduisent leur politique étrangère et prennent leurs décisions diplomatico-stratégiques. Sur fond de thèses réalistes (radicale séparation externe-interne; primauté de l’intérêt national transcendant par rapport aux intérêts particuliers) et élitistes (différence élite-peuple, rationalité parfaite de pouvoir exécutif) partagées tant par les théoriciens que par les praticiens, la politique étrangère fait l’objet d’une monopolisation tendancielle par le ‘prince’ et continue de relever du domaine réservé. La politique étrangère est de ce fait une politique qui n’a de publique que le nom et qui en réalité est a-démocratique.
Résumé concentré de ma thèse ‘Le discours de l’intérêt national. Politique extérieure et démocratie’, cet article a fait l’objet dans le même numéro du Débat d’un dossier comportant les critiques de S. Cohen, P. Delmas, et M. Touraine, ainsi que ma réponse à ces critiques.
« Recherche ennemi désespérément. Réponse à Samuel Huntington à propos d’un affrontement à venir entre l’Occident et l’Orient »
Confluences Méditerranée, N°12, automne 1994, p. 143-155
Cet article est une critique de la thèse du ‘Choc des civilisations?’ publiée par S. Huntington en 1993. Il montre que cette thèse est fondée sur une vision culturaliste de la politique, qu’il réhabilite une conception schmittienne des relations internationales, et qu’il constitue un appel idéologique à la lutte contre un ‘nouvel empire du mal’.
Cet article a été republié au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, avec une postface inédite, dans le N°40, hiver 2000-2001, p. 81-94.
« Fin de la guerre froide, fin de l’état de guerre? »
Politique étrangère, 58 (3), automne 1993, p. 747-761
Cet article s’interroge sur la signification profonde de la fin de la guerre froide, et postule que la multiplication de relations transnationales, le recours à des moyens tels que la influence politics, et la perspective d’un système international homogène sont autant de processus susceptibles de permettre le dépassement de l’état de guerre hobbien caractéristique du 20e siècle.
CONTRIBUTIONS À DES OUVRAGES COLLECTIFS
« Edward H. Carr and Carl Schmitt: Interwar Realism’s Not So Strange Bedfellows »,
in A. Reichwein & F. Rösch (eds.), Realism: A Distinctively 20th Century European Tradition, Basingstoke, Palgrave MacMillan, 2020, p. 29-44
“The Twenty Years’ Crisis. A Complete Picture of the Chaotic Period of Transition Between 1919 and 1939”. If Edward H. Carr and Carl Schmitt had co-written a book, they probably would have chosen the above two sentences as title and sub-title. As a matter of fact, in “The Twenty Years’ Crisis. 1919-1939”, Carr aimed at accounting for the “the abrupt descent from the visionary hopes of the first post-War decade to the grim despair of the second”. As regards Schmitt, in his « Nomos … » he ascribed the “chaotic period of transition between 1919 and 1939” to America’s decision to withdraw from Europe after having made “the most important attempt at […] a new order of international law”, thus leaving “the European peoples to their political fate”. Put differently, both Carr and Schmitt, whatever their differences, shared the same analysis of the interwar period as a transition phase following a stable order and they unmasked the hypocrisy of the then predominant liberal practice and idealist vision of international politics. In doing so, they set the foundations of political realism that was to triumph after WWII.
« Kant trahi. De la paix perpétuelle aux guerres démocratiques »,
dans P. Troude-Chastenet (sld.), Penser et panser la démocratie, Paris, Classiques Garnier, 2017, p. 169-186
Depuis Wilson et a fortiori depuis Fukuyama, les démocraties libérales contemporaines se complaisent dans l’auto-promotion de leur image comme États pacifiques. Or, un simple coup d’oeil sur les statistiques de l’après-guerre froide permet de constater que les démocraties occidentales multiplient les guerres, au point de faire preuve de ce qu’il faut bien appeler militarisme démocratique ou violence démocratique. Ce faisant, elles trahissent la philosophie de Kant dans ses dimensions tant normative – les articles préliminaires de la paix perpétuelle – qu’analytique – les articles définitifs de la paix perpétuelle.
« Les tabous de la société internationale »,
dans B. Blancheton et al. (sld.), Pour une histoire globale des réseaux de pouvoir, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2017, p. 217-224
Comme l’indique l’allusion contenue dans le titre, cette publication est une contribution aux mélanges offerts au professeur Hubert Bonin qui avait publié, en marge de son activité d’historien de l’économie, une analyse de ce qu’il avait nommé dans une formule heureuse Les tabous de Bordeaux. Il s’agit plus précisément d’une critique de la face cachée de la société internationale contemporaine qui, volontiers assimilée à la communauté internationale, procède en fait par surveillance-punition des Etats tant faillis que voyous.
« De la Pax britannica à la Pax americana, ou l’histoire des RI saisie par la théorie des RI »
dans Hubert Bonin et al. (sld.), Le Royaume-Uni, l’Europe et le monde, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 2015, p. 193-205
A partir de la théorie des cycles de puissance associée à Robert Gilpin en théorie des RI et à Paul Kennedy en histoire des RI, cette contribution aux mélanges offerts au professeur François-Charles Mougel procède à une comparaison des hégémonies britannique au cours du long dix-neuvième siècle et américaine depuis la fin de la guerre froide, sinon depuis 1945: quels facteurs ont favorisé l’émergence des deux hégémonies? comment les deux hégémons ont-ils exercé leur leadership? l’hégémonie américaine subira-t-elle un déclin comparable à celui qu’a connu l’hégémonie britannique?
« La théorie des relations interétatiques »
dans Antonin COHEN, Bernard LACROIX, et Philippe RIUTORT (sld.), Nouveau manuel de science politique, Paris, La Découverte, 2015, p. 695-706
Ce chapitre présente les trois grandes approches théoriques contemporaines des relations entre États, rapports de puissance selon les (néo-)réalistes, de coopération selon les (néo-)libéraux, d’identité selon les constructivistes. A quelques détails près, il reprend l’analyse proposée dans la première version de ce chapitre publiée en 2009 dans la première édition du Nouveau manuel de science politique.
« La guerre justifiée, ersatz réaliste de la guerre juste »
dans Julie SAADA (sld.), La guerre en question, Lyon, PUL, 2015, p. 149-162
En s’opposant, à la veille de l’Opération Iraqi Freedom, à la politique de l’administration Bush fils, la fine fleur des réalistes américains s’est retrouvée dans le même camp que les doctrinaires de la guerre juste, tout aussi critiques envers cette agression armée. L’objectif de ma contribution à cet ouvrage s’interrogeant sur l’évolution récente de la guerre est de montrer que cette position n’est pas aussi surprenante que cela, si seulement on prend en compte les soubassements normatifs du réalisme moderne. Politiquement conservateurs, éthiquement prudents, épistémologiquement rationalistes, les réalistes contemporains sont tout sauf des va-t-en guerre : s’ils constatent la récurrence des guerres à travers les âges, ils voient dans la guerre un instrument et non une fin. En posant que la guerre n’est justifiée que lorsqu’elle permet à celui qui y recourt d’espérer obtenir ce que la diplomatie n’a pas permis de réaliser, l’approche réaliste véhicule une dimension praxéologique qui se rapproche des critères de la guerre juste posés depuis Grotius jusqu’à Walzer.
A noter la participation à cet ouvrage de deux très grosses pointures de la théorie politique mondiale : Michael Walzer justement, ainsi que Jürgen Habermas – excusez du peu !!!
« Les RI en France »
dans Thierry BALZACQ et Frédéric RAMEL (sld.), Traité de relations internationales, Paris, Sciences Po les Presses, 2013, p. 157-179
Ce chapitre analyse la situation des RI au sein du champ de la science politique française. Il montre qu’après un décollage difficile dans un contexte académique caractérisé par la domination des RI d’abord britanniques puis américaines, la théorie des RI a été introduite en France grâce au travail pionnier de R. Aron. Ce dernier a cependant été réapproprié d’une façon orientée par son opposant M. Merle, behaviouriste et de facto empiriste. Conséquence : la sociologie des RI, dont se réclament ceux des internationalistes français de la génération contemporaine qui sont venus aux RI après avoir été formés dans d’autres branches de la science politique, défend avec succès une déconnexion des RI françaises par rapport aux recherches en cours dans la discipline mondiale des RI. Reflet d’un manque de maîtrise de la théorie, la conception des relations internationales comme objet plutôt que comme (sous-)discipline relève d’une stratégie de conservation par reproduction des RI telles qu’elles se pratiquent au sein de la science politique française établie – qui elle-même tient les RI en piètre estime …
Lire la critique de Noe Cornago Prieto dans la European Review of International Relations
« La politique étrangère ante-moderne des Etats post-modernes »
dans Patrick LEHINGUE et al. (sld.), Mélanges en l’honneur du professeur Jacques Chevallier, Paris, Lextenso Editions, 2013, p. 531-540
Dans cette contribution aux Mélanges offerts à Jacques Chevallier, qui a dirigé ma thèse et à qui je dois d’être entré dans la carrière universitaire, je défends l’idée que les Etats post-modernes, dont Jacques a analysé avec rigueur le fonctionnement interne dans son ouvrage classique « L’Etat post-moderne » paru aux Editions LGDJ, mènent une politique étrangère ante-moderne dans leurs rapports avec les Etats qu’ils désignent comme voyous et faillis.
« Le concept de puissance »
dans Eric OUELLET, Pierre PAHLAVI, et Miloud CHENNOUFI (sld.), Les études stratégiques au XXIe siècle, Outremont (Québec), Athéna Editions, 2013, p. 103-146
Cette contribution cherche à proposer une conception synthétique de la puissance partant de l’hypothèse que l’exercice effectif de la puissance qui, tant comme relation que comme structure, repose toujours sur un ensemble de ressources, dépend en dernière analyse du contexte international au sein duquel il se déploie. Le chapitre est divisé en trois parties. La première partie rappelle les débats scientifiques sur les notions de pouvoir et de puissance et pose les préalables épistémologiques de l’analyse proposée. Dans la deuxième partie sont étudiées les modalités de la puissance comme relation que sont la puissance sur la conduite d’autrui (capacités de contraindre et d’influencer) et sur l’environnement d’autrui (capacités de réguler et de structurer). La troisième partie analyse les conditionnements de la puissance en action, en montrant que l’exercice de la puissance est fondé sur des ressources (tangibles et intangibles) et que son efficience dépend du contexte d’interaction, avec la puissance soft appropriée au sein de la société internationale et la puissance hard indispensable au-delà de la société internationale.
« Les théories des RI aujourd’hui »
dans Pierre HASSNER (sld.), Les relations internationales, Paris, La Documentation française, 2e édition, 2012, p. 15-24
Dans un recueil à visée pédagogique, cette contribution expose l’opposition fondamentale autour de laquelle s’articule la discipline des RI. Réalisme et libéralisme se différencient quant à l’acteur de référence qu’ils revendiquent (Etat vs. individu), à la nature du système international qu’ils postulent (anarchie comme état de guerre vs. anarchie comme état de coopération), à l’art diplomatique qu’ils conseillent (prudence élitiste vs. diffusion de la démocratie de marché).
« La résolution 687 (1991) du Conseil de Sécurité des NU : Iraq-Koweït »
dans Mélanie ALBARET et al. (sld.), Les grandes résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, Paris, Dalloz, 2012, p. 121-136
Dans cet ouvrage collectif réunissant internationalistes juristes et politistes, ma contribution analyse la résolution mettant fin à l’opération armée Tempête du Désert comme une mesure d’inspiration fondamentalement lockienne tout en véhiculant un risque de dérives hobbésiennes de par l’instrumentalisation du CS au profit de la Realpolitik américaine.
« Raymond Aron: a neoclassical realist before the term existed? »
in Asle TOJE and Barbara KUNZ (eds.), Neoclassical Realism in European Politics: Bringing Power Back In, Manchester, Manchester UP, 2012, p. 117-137
Dans cet ouvrage qui réunit une douzaine d’internationalistes principalement européens autour du thème de la pertinence du réalisme néoclassique pour comprendre les relations internationales contemporaines, ce chapitre défend l’idée que Raymond Aron est le fondateur méconnu du réalisme néo-classique en vogue aujourd’hui outre-Atlantique. Entre autres il a, en effet, combiné des variables indépendantes situées au niveau du système anarchique – distribution de la puissance – et des variables intermédiaires situées au niveau de l’acteur – perception et rapports Etat-société civile – pour mieux rendre compte de la politique extérieure des États.
« Preemptive War »
in Bertrand BADIE, Dirk BERG-SCHLOSSER & Leonardo MORLINO (eds.), International Encyclopedia of Political Science, Thousand Oaks (Cal.), Sage Publications, 2011, p. 2121-2123
Cette courte entrée rappelle la définition de la notion de guerre préemptive et sa – difficile – différenciation par rapport à la notion de guerre préventive, avant de montrer, à partir de l’Opération ‘Liberté en Irak’, les tentatives en cours de relégitimation des guerres préventives pour cause de changement des menaces censées peser sur les démocraties.
« La démocratie et la guerre »
dans Jean-Vincent HOLEINDRE et Benoît RICHARD (sld.), La démocratie. Histoire, théories, pratiques, Auxerre, Editions Sciences Humaines, 2010, p. 157-169
Confrontée à la guerre ou au risque de guerre, les démocraties sont régulièrement tentées, au nom de la nécessaire lutte pour sa survie, de renier ses fondements que sont la liberté des citoyens et la séparation des pouvoirs. Pourtant, l’histoire montre que les démocraties gagnent les guerres qu’elles mènent grâce justement à leurs vertus démocratiques. Déduction : les tentations liberticides des démocraties ont pour fonction d’empêcher toute critique de guerres injustes et mesquines.
« Penser la guerre au XXIe siècle »
dans Stéphane PAQUIN et Dany DESCHENES (sld.), Introduction aux relations internationales. Théories, pratiques et enjeux, Montréal, Chenelière, 2009, p. 77-96
Après avoir défini le concept de guerre et distingué guerres inter- et infra-étatiques, ce chapitre rappelle l’évolution de la violence entre entités politiques dans le passé, propose une lecture des guerres contemporaines à travers la grille d’analyse proposée par le concept de complexe de sécurité, et s’interroge sur les tendances probables du phénomène guerre au 21e siècle.
« Démocratie et domaine réservé. ‘Liberté en Irak’ ou la double réfutation du paradigme tocquevillien », dans Pierre SADRAN et al. (sld.), Mélanges en l’honneur de Slobodan Milacic, Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 717-726
D’après Tocqueville, la démocratie est le pire de tous les régimes en matière de conduite diplomatico-stratégique, à cause de la dépendance des élites gouvernantes clairvoyantes par rapport aux masses populaires ignorantes. Cette contribution réfute les deux postulats en question: la crise puis la guerre irakiennes de 2002-2003 ont montré que les dirigeants agissent indépendamment de leurs opinions publiques en cas de divergences entre les deux, alors que les conséquences de ‘Liberté en Irak’ ont montré que lesdits dirigeants sont tout sauf plus clairvoyants que leurs citoyens.
« Faire de la paix un bien public global? Plaidoyer pour la paix démocratique »
dans François CONSTANTIN (sld.), Les biens publics mondiaux. Un mythe légitimateur pour l’action collective?, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 191-215
Cette contribution montre que si la paix existe lorsque prévaut entre États une volonté avérée à ne pas se battre, alors une telle paix ne saurait être instaurée par une quelconque autorité collective type Conseil de Sécurité, mais ne peut découler que des interactions entre unités étatiques elles-mêmes devenues démocratiques.
« L’intérêt national. Une notion, trois discours »
dans Frédéric CHARILLON (sld), Politique étrangère. Nouveaux regards,
Paris, Sciences Po les Presses, 2002, p. 139-166
Omniprésent dans les discours politiques, le concept d’intérêt national est aussi utilisé dans un sens considéré comme savant par les trois grandes approches théoriques en RI. Pour les réalistes, l’intérêt national est défini en termes de rapports de puissance, pour les libéraux il est issu des préférences sociétales, pour les constructivistes il est construit par la culture internationalement partagée.
Lire la critique de John Groom dans La Revue Internationale et Stratégique
DIVERS
« Préface à E. H. Carr, La crise de vingt ans. 1919-1939 »
dans Edward H. Carr, La crise de vingt ans, 1919-1939. Une introduction à l’étude des relations internationales, Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2015, p. 7-32
Œuvre classique s’il en est, fondatrice de l’approche savante des relations internationales, l’ouvrage de E. Carr a été successivement stigmatisé par les idéalistes, encensé par certains réalistes mais aussi négligé par d’autres, et enfin réhabilité par des théoriciens critiques. Après avoir présenté les grandes lignes de l’ouvrage, rappelé la réception à laquelle il a eu droit de la part des internationalistes établis, et contribué à la « Carr industry » en expansion continue en résumant son apport sous le label de paradigme de la domination, cette préface avance l’idée que sa valeur ajoutée est intemporelle, et sa portée plus heuristique que jamais de nos jours, du fait des deux apports que Carr reconnaît lui-même à son réalisme d’inspiration marxiste, à savoir sa capacité « à mettre en évidence les aspects déterministes du processus historique mais aussi le caractère relatif et pragmatique de la pensée elle-même ».
« Post-Cold War Order »
Academic Foresights, January 2013
The proposed analysis – an updated summary of my two books published in 2011, that is Un monde unidimensionnel, and Paix et guerres au 21e siècle – asserts that the contemporary world order is unipolar as far as the structure of the interstate system is concerned, relatively to the power configuration among major state-actors, and uniform as far as the nature of international society is concerned, relatively to the set of norms and institutions regulating international relations.
« The Post-Cold War Order as a One-Dimensional World »
Colección de Estudios Internacionales, Universidad del Pais Vasco, N°12, 2012, 48 p.
This research paper proposes an analysis of the contemporary world order as being dialectically characterized by a unipolar structure of the international system on the one hand, and by a uniform culture of the international society on the other. The prevalence of neoliberal norms regulating international interactions reflects the material primacy of the US and its Western allies, whereas the pre-eminence concerned is reproduced by the said international institutions. Stable in the short term, this order is likely to evolve in the long run, due to the rise of China and the ensuing great game to come located in East Asia.
« ‘Le nomos de la terre dans le droit des gens du jus publicum europaeum’ de Carl Schmitt. Compte rendu critique »
Politique étrangère, 68 (2), été 2003, p. 423-425
Ce compte-rendu montre que l’ouvrage de Schmitt, traduit en français aux PUF quelque 50 ans après sa parution, est d’une surprenante actualité: il permet mieux que de nombreuses analyses contemporaines de dévoiler la face cachée de l’hégémonie libérale caractéristique du monde de l’après-guerre froide.








